En 1637, la "Querelle du Cid" déclenche une avalanche de pamphlets sur la nécessité de normes au théâtre. Elle
précipite un débat déjà amorcé et qui a abouti dans la décennie suivante à une stricte codification de la
dramaturgie. Leur but : adapter le concept aristotélicien de catharsis (ou "purge des passions") au monde moderne. Pour cela, la représentation doit être "vraisemblable", c’est-à-dire donner l’illusion de la réalité. Il existe aussi, en
cette période de raffermissement de l’ordre, l’idée chez les écrivains que la beauté et la grâce naissent du travail et de la discipline, et non de l’improvisation.
1637년의 < 르 시드 > 논쟁은 연극에서 규범의 필요성을 제기하는 소논문이 쏟아지는 계기가 되었다. 이렇게 발표된 일련의 소논문들은 이미 논란의 대상이었던 이 문제를 쟁점화시켜 1640년대 들어서는 엄격한 극작술이 정형화되기에 이른다. 감정의 정화를 의미하는 아리스토텔레스적 카타르시스 개념을 당대에 적용하기 위하여 연극적인 재현은 현실이라는 느낌을 주는 사실임직하게 받아들여져야 한다. 질서가 공고해지는 이 시기에 아름다움과 우아함은 즉흥적으로 만들어지는 것이 아니라 공이 들어간 작가의 작업과 규율에서 만들어진다는 생각이 자리잡게 되었다.
De ce souci de crédibilité découlent les célèbres règles. L’unité de temps veut que la durée de la pièce corresponde à celle de l’histoire représentée (les entractes, nécessaires techniquement, permettent d’allonger ce temps fictif à
une journée). Il en résulte l’unité de lieu (on ne peut pas beaucoup se déplacer en vingt-quatre heures) et l’unité
d’action (un seul sujet auquel tout est subordonné). Une quatrième unité proscrit les mélanges chers au baroque.
Chaque pièce est organisée selon un certain nombre de paramètres, et quand ceux-ci varient elle s’inscrit dans un
genre ou un autre, les catégories étant très normalisées. Aussi la tragédie possède un langage "élevé", des héros
nobles, une tension constante, un dénouement malheureux ; la comédie utilise un style "bas", des protagonistes
roturiers, un déroulement relâché et une fin optimiste. Autre règle fondamentale : la bienséance, qui interdit de
choquer autrui par des audaces scéniques (plus de spectacles sanglants) et morales (l’indécence est bannie, les
personnages doivent rester conformes à leur condition sociale).
무대에서 보여지는 것에 신빙성을 부여하려는 노력에서 유명한 규칙들이 만들어진다. 시간의 단일성은 무대에서 재현되는 사건의 시간과 작품의 지속 시간을 일치시키려고 한다. 무대 공연의 기술적인 문제로 불가피하게 필요한 막간의 시간은 가상의 시간을 하루 정도까지 확장시킨다. 시간의 단일성에서 하루 동안 너무 많은 지역을 이동할 수 없다는 장소의 단일성, 하나의 주제에 모든 것이 종속되어야 한다는 사건이 단일성이 추가되었다. 네 번째 단일성은 바로크 미학에서 유행한 장르의 혼용을 금지한다. 각 작품은 일정한 변수에 따라 만들어지되 그 범주가 매우 규범화된 까닭에 어떤 하나의 장르에 속해야 한다. 그런 차원에서 비극은 고상한 언어를 구사하는 귀족적 주인공이 등장하여 지속적인 긴장을 유지하다가 불행한 대단원으로 종결된다. 한편 희극은 귀족 출신이 아닌 주인공들이 등장하여 고상하지 않은 언어를 구사하며 비극에 비하여 이완된 상태에서 진행되는 사건이 낙관적인 결말로 종결된다. 이 시기에 요구된 핵심적 규칙 가운데 적합성의 원칙은 유혈이 낭자하거나 외설스러운 장면을 무대에서 보여주는 것은 금지하며 등장인물의 당시의 사회 상황에 부합하는 것을 요구하였다.
Les conséquences dramaturgiques sont indéniables : peu de comédiens sur scène, une homogénéité structurelle
(situation de crise, avec un rebondissement et un épilogue rapide), le rôle fondamental du récit (toute l’action proprement dite se passant en coulisse). Ces règles vont être de plus en plus strictes, voire drastiques. Après 1685, elles
auront tendance à figer le théâtre français après lui avoir permis de connaître un âge d’or.
이같은 연극적 규칙이 적용되면서 다음과 같이 부정할 수 없는 결과를 야기하였다. 무대에 등장하는 배우의 수는 제한되었고 위기상황에 이은 사건의 새로운 전개, 신속한 에필로그 등 구조적인 차원에서 동질적 특성을 가지며 이야기에 핵심적 기능이 강조되었다. 그러므로 진정한 의미의 행동은 무대 뒤에서 이루어진다. 프랑스 연극의 황금기를 만들어낸 바 있는 연극의 제규칙은 점점 더 엄격해지고 철저하게 적용되기에 이르러, 1685년 이후로는 프랑스 연극 전반을 고착화시키는 경향을 보여준다.
* Quelques textes importants : 주요 참고문헌
Jean Chapelain, Lettre sur la règle des vingt-quatre heures (1630)
Jean Chaepain, Discours sur la poésie représentative (1635)
Hippolyte Jules Pilet de La Ménardière, Poétique (1640)
Jean-Louis Guez de Balzac, Lettres
Georges de Scudéry, Observations sur le Cid (1637)
Georges de Scudéry, Les sentiments de l’Académie sur la tragi-comédie du Cid (1638)
Gérard-Jean Vossius, Poétique (1647)
François Hédelin abbé d’Aubignac, La Pratique du théâtre (1657)
Pierre Corneille, Trois discours sur le théâtre (1660) – Examens (1660)
Nicolas Boileau, L’Art poétique (1674)
René Rapin, Réflexions sur la Poétique d’Aristote (1675)
* Source : http://gallica.bnf.fr/themes/LitXVIIz6.htm
* 이경의님에 의해서 게시물 이동되었습니다 (2016-03-15 10:59) |
|
 80
80 4
4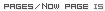 3
3 



 80
80 4
4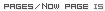 3
3 


